|
|
|
Histoire de la Guinée-Bissau
| 
Empire du Ghana du XIe au XIIIe siècle

Empire du Mali du XIII au XVIIe siècle
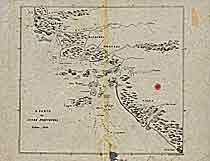
Carte de la Guinée portugaise datant de
1843 (cliquez
pour agrandir)

Le costume traditionnel d'une femme Papel en 1906
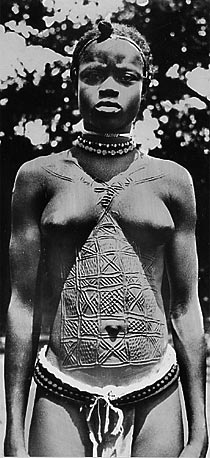
Jeune féticheuse manjak scarifiée
sur l'île de Pecixe
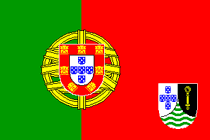
Drapeau de la Guinée portugaise
|
L'histoire
de la Guinée-Bissau ne remonte pas aux quelques
années qui ont secoué cette petite république
africaine depuis plus de quinze ans.
Les troubles qui sont continuent jusqu'à aujourd'hui (présidence par intérim) et qui ont causé la mort de trop de personnes ne doivent
pas occulter le passé si riche de la Guinée.
La Guinée-Bissau n'a été "découverte"
par les Européens que moins de 50 ans avant que
Christophe Colomb ne foule le continent américain.
En effet, 1446 marque le début de l'établissement
portugais sur les côtes bissau-guinéennes mais
également le début d'une résistance à l'envahisseur
des populations locales qui allait durer jusqu'au
20ème siècle. En effet, le premier navigateur
portugais Nuno Tristão est tué en 1446 et le dernier
portugais avant la guerre de libération sera tué
en 1939 par les guerriers Bijagos. Le premier
comptoir sera Bolama, situé sur l'île du même
nom, en face de l'actuelle Bissau au cœur de l'Empire
du Gabù. Le commerce peut alors commencer
: or, ivoire, poivre... et esclaves.
L'histoire coloniale
Au XIIIème siècle,
les peuples Nalu et Landuma s'installent dans
la région à la faveur du déclin
de l'Empire du Ghana. C'est seulement au XIVe
siècle, en 1446, alors que la région
est en passe d'être intégrée
au vaste Empire du Mali (qui comprend les actuels
Sénégal, Guinée, Gambie et
Mali,...) que les premiers navigateurs portugais
établissent des contacts.
L'histoire coloniale commence, comme partout dans
le monde, par l'établissement de quelques
comptoirs commerciaux qui permettront aux Portugais
d'acheter des esclaves ou de l'or. La richesse
et le potentiel de la Guinée-Bissau la
feront se faire disputer également par
les Français, les Hollandais et les Anglais.
En 1588, les Portugais fondent Cacheu, dans l'estuaire
du Rio Cacheu, qui devient ainsi la première
implantation portugaise dans la région
qui sera dès lors dirigée par des
gouverneurs directement nommés par le roi
du Portugal sous la juridiction du Cap Vert. La
deuxième grande implantation coloniale
sera Gêba, bien à l'intérieur
des terres (à une quinzaine de kilomètres
de Bafatá).
Dès le milieu du XVIIe siècle, les
Portugais accélérent la cadence
coloniale : en 1642, ils fondent Farim et Ziguinchor (aujourd'hui au Sénégal) en déplaçant
des familles de colons depuis la ville de Gêba.
C'est à la même époque que
les estuaires du Rio Buba, du Rio Cacheu, du Rio
Gêba et du fleuve Casamance commencent réellement
à être fréquentés en
vue d'échanges commerciaux et de colonisation
de masse.
Entre 1753 et 1775, la construction
de la forteresse de Bissau s'effectue grace au
travail de Capverdiens spécialement déplacés
pour ces travaux. En 1800, l'Angleterre commence
à faire sentir son influence en Guinée
Bissau en revendiquant la tutelle de l'île
de Bolama, de l'archipel des Bijagos, de Buba et de tout le littoral Sud.
A la fin du 19ème siècle,
l'abolition de l'esclavage est imposée par les
patrouilles de surveillance de la marine britannique.
Ainsi, l'exportation des produits agricoles vers
l'Europe devint l'activité principale des puissances
coloniales en Afrique occidentale. Le Portugal
n'étant pas un pays riche et n'ayant que peu de
ressources, il ne pût développer ses colonies.
Le gouvernement portugais était si faible qu'il
permit aux compagnies européennes de contrôler
et d'exporter les richesses de la Guinée,
principalement l'arachide et l'huile de palme.
En 1870, grace à l'arbitrage
du président américain Grant, l'Angleterre
renonce à ses revendications en Guinée-Bissau.
Malgré ce partage effectif du pays par
les puissances coloniales, les royaumes locaux
continuent à résister à toute
tentative de colonisation et d'expropriation.
Les Floups, une des communautés diola les
plus puissantes et présente principalement
vers Oussouye en Casamance sénégalaise,
mènent contre les Portugais la bataille
de Djufunco en 1879. Cette bataille se soldera
par la plus grande déroute portugaise de
l'histoire coloniale. Cette résistance
sévère des Diolas mènera
le Portugal à accentuer sa pression sur
le pays en lui donnant plus de prérogatives
: la Guinée est séparée de
la Province du Cap Vert et la nouvelle Province
de Guinée Portugaise qui aura comme capitale
Bolama.
Commencent alors l'occupation militaire du pays
par l'armée portugaise et les actions punitives
contre les guerriers Pepels de Bissau et du Biombo (1882-1884), contre les Balantes à Nhacra (1882-1884), contre les Manjaks à Caió
(1883) et contre les Beafadas à Djabadá
(1882). L'adage "diviser pour mieux règner"
fait alors le bonheur du colon portugais qui utilise
à bon escient les antagonismes ethniques
en armant les communautés ethniques les
unes contre les autres comme en 1881-1882 où
les Peuls Noirs (musulmans) sont armés
contre les Peulhs Rouges (animistes).
Malgré tout, la tension
militaire et la rebellion permanente font que
le pouvoir colonial portugais se limite aux villes-forteresses
occupées par l'admnistration et l'armée
: Bissau, Bolama, Cacheu Farim et Gêba.
Cette insécurité n'empêche
pas la mise en production agricole des terres
littorales par les colons portugais ou du monde
lusophone (notamment des Caverdiens).
C'est seulement en mai 1886 que les frontières
de la Guinée-Bissau sont fixées
en accord avec la France qui possède le
Sénégal et la Guinée Conakry.
La Casamance passe alors sous domination française
en échange de la région de Cacine qui passe sous contrôle portugais.
Mais la rebellion reprend de
plus belle dès la fin du XIXe siècle
avec une vague insurrectionnelle dans l'Oio (en
1897 et 1902), dans le pays Floup (encore...)
en 1905 et à Bissau en 1908 qui voit l'alliance
des Pepels et des Balantes de Cuméré
pour une offensive meurtrière. Entre 1910
et 1925, une période de conflit permanent
alternant des insurrections autochtones et la
répression coloniale sera appelée
"la guerre de pacification". Il s'agissait
plutôt en guise de pacification d'assassiner
les chefs locaux les plus rétifs tout en
accentuant l'impôt sur les populations locales.
Entre victoires et déroutes des populations
insoumises, deux noms resteront dans l'histoire
de la répression sanglante : le premier
fut João Teixeira Pinto, militaire à
la longue expérience coloniale et qui entre
1913 et 1915 lança des actions sanguinaires
qui virent le massacre des populations locales
durant la campagne de l'Oio (pays balante). Le
second fut Abdul Indjai (Abdoul Ndiaye), un Wolof
sénégalais (les Wolofs furent les
plus grands vendeurs d'esclaves dans cette partie
de l'Afrique). Abdul Indjai qui fut l'auxiliaire
cruel de Teixeira Pinto dans la bataille de Canchungo,
finit par se rebeller et fût arrêté
à Mansabá en 1919 avant d'être
déporté vers le Cap Vert et plus
tard à Madeire (peut-on faire confiance
à un Sénégalais ?). A leur
tour, les Bijagos se révoltent entre 1917
et 1925 harcelant l'armée portugaise dans
tout l'archipel et jusqu'à Bolama. En 1918,
les Bayots et les Floups (encore des Diolas) entament
une nouvelle guerilla meurtrière contre
le Portugal. C'est à cette période
qu'une nouvelle administration légiférant
la ségrégation colonialiste est
mise en place en Guinée-Bissau. Elle formalise
:
- la division de la population
entre "civilisés" et "indigènes"
- la légalisation du recrutement sous le
régime du travail obligatoire
- l'imposition du lieu de résidence et
ainsi la limitation de la circulation des "non
civilisés" en dehors de leur village
- le type de relations entre l'administration
coloniale, les auxiliaires indigènes et
les autorités coutumières (rois
locaux, chefs de village, etc...)
En 1921, à la prise de
fonction du gouverneur Jorge Velez Caroço,
de nouvelles alliances verront les musulmans -
et notamment les Peulhs, être privilégiés
par le pouvoir colonial au détriment des
communautés animistes mal organisées.
Entre 1925 et 1940, ce sont à
nouveau les Pepels de Bissau qui se révoltent,
suivis en 1933 par les Floups de Jufunco qui font
du pays Diola (extrême Nord-Ouest) une région
toujours incontrôlée. Les Bijagos
de l'île de Canhabaque (île Roxa)
suivent le mouvement de révolte en 1935-36
et refusent de payer l'impôt au pouvoir
colonial. Malgré cette insurrection quasi-généralisée,
l'administration coloniale lance la construction
d'infrastructures : routes, ponts et élargissement
du réseau électrique, etc... La
principale culture d'exportation, l'arachide,
est également développée.
C'est également à
cette époque que les grande entreprises
de capital portugais viennent se créer
ou s'implanter en Guinée portugaise. C'est
le cas de l'Estrela de Farim et de la Casa Gouveia
qui commercialisent l'arachide et gèrent
la distribution de produits dans tout le territoire.
Dans le même temps, de grandes exploitations
agricoles sont également développées
dans les rares régions pacifiées
: le long du Rio Grande de Buba, autour de Bissau
et dans le pays peulh (Bafatá et Gabú).
Cet essor économique portugais est favorisé
par le coup d'état de Lisbonne en 1926 : le dictateur
Salazar prit le pouvoir et imposa des droits de
douane restrictifs aux compagnies étrangères présentes
en Guinée, les forçant à se vendre aux
intérêts portugais.
L'organisation sociale coloniale
pyramidale en ce milieu de XXème siècle
trouve en son sommet une poignée de dirigeants
et de cadres techniques portugais. Le niveau intermédiaire
est composé de fonctionnaires, majoritairement
capverdiens (75% !). Cette communauté capverdienne
domine également le secteur commercial.
Le niveau social le plus défavorisé
est évidemment composé des natifs
bissau-guinéens qui occupent des fonctions
de domestiques, d'artisans et d'agriculteurs.
En 1942, Bissau qui était
déjà de facto la capitale économique
et la plus grande "ville" du pays devient
la capitale administrative de la Guinée
portugaise aux dépens de Bolama.
En 1950, sur les 512.255 habitants
de Guinée portugaise, seuls 8320 étaient
considérés comme "civilisés"
(dont 2273 blancs, 4568 métis, 1478 noirs
et 11 indiens). Sur ces 8320 civilisés,
3824 étaient analphabètes (541 blancs,
2311 métis et 772 noirs). En 1959, à
la veille de la vague d'indépendances africaines,
seuls 3525 élèves fréquentaient
l'enseignement primaire et 249 le lycée
Honório Barreto (créé l'année
précédente). L'Ecole Industrielle
et Commerciale de Bissau accueillait quant à
elle 1051 élèves. Le Portugal aborde
donc les années 50 avec un bilan désastreux
: les provinces de Guinée portugaise sont
toujours insoumises, le pays n'a que peu d'infrastructures
et les systèmes scolaires et sanitaires
sont quasi-inexistants.
 Liste des gouverneurs de la Guinée-Bissau
Liste des gouverneurs de la Guinée-Bissau
|
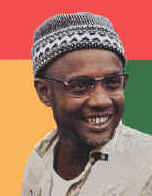
Amilcar Cabral,
le héros de l'Indépendance

Jeunes filles partant au
combat durant la guerre
(photo Mario de Andrade)

Amilcar Cabral et ses
lieutenants pendant la Guerre
(photo Mario de Andrade)

Amilcar
(photo Mario de Andrade)
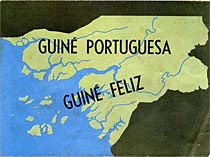
Affiche de propagande portugaise : "Guinée
portugaise : Guinée heureuse"
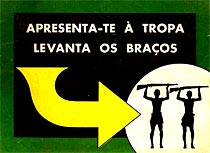
Affiche de propagande portugaise :
"Présentez-vous devant l'armée
en levant les bras"

Intérieur du Fort S.JOSE à BISSAU au
début du siècle. Ce fort était le point de départ
des troupes coloniales pour la conquête du territoire.

HISTOIRE DU PORTUGAL ET DE SON EMPIRE COLONIAL
de OLIVEIRA MARQUES
 Voir
aussi la page "des photos de jadis"
avec des cartes postales anciennes de Guinée-Bissau
Voir
aussi la page "des photos de jadis"
avec des cartes postales anciennes de Guinée-Bissau
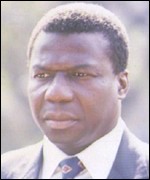
Nino Vieira : ex-président de la
Guinée-Bissau et ex-narcotraficant notoire |
La lutte pour l'Indépendance
De la fin des années 50 jusqu'au
début des années soixante beaucoup de pays en
Afrique accédaient à l'indépendance.
Mais le Portugal refuse d'abandonner ses colonies.
Les Portugais se sont rendus compte que si elles
étaient libérées, le néo-colonialisme de Salazar
ne pourrait pas être imposé. Ainsi, alors que
d'autres pays devenaient libres, l'emprise sur
la Guinée s'affermit. Le résultat fût la plus
longue guerre de libération que connut l'Afrique
: une guerre de "guerilleros" menée
par le PAICG avec l'aide significative d'Union
Soviétique et du Cuba.
Dans les années 50, alors
que le pays ne s'était jamais vraiment
soumis à l'occupant portugais et que plusieurs
régions africaines s'émancipent,
les idées indépendantistes commencent
à germer et mènent à la création
en 1956 du Parti Africain pour l'Indépendance
de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC) dont
le fondateur n'est autre qu'Amilcar
Cabral.
La fin de la décennie marquera le début
de la fin pour le Portugal en raison d'un évènement
aujourd'hui entré dans l'histoire de la
Guinée-Bissau. Le 3 août 1959, la
grève des marins et dockers du port de
Bissau est violemment réprimée par
l'armée portugaise : plus de 50 morts seront
à déplorer et cette journée
restera dans l'histoire comme le "massacre
de Pidjiguiti". C'est l'étincelle
qui fera prendre au PAIGC la voie de la lutte
armée et le chemin de la guerre d'indépendance.
Quatre années seront nécessaires
au PAIGC pour s'organiser et s'armer. Cette guerre
de libération commencera vraiment en 1963
et grâce à des actions de guerilla
permettra à l'armée de libération
d'occuper 5 ans plus tard, en 1968, plus de deux
tiers du territoire.
Désormais politiquement
et militairement bien organisé, le PAIGC
réussit rapidement à s'attirer la
sympathie et la bienveillance de plusieurs nations
du monde telles que la Suisse, l'Union Soviétique,
la Chine et de nombreux pays du tiers-monde dont
le Maroc et la Guinée Conakry. Le monde
intellectuel, diverses forces sociales et politiques
ainsi que la jeunesse des pays d'Europe occidentale
et des Etats-Unis soutiennent ce mouvement d'émancipation
et lui permettent d'obtenir en plus des appuis
matériels et logistiques une tribune pour
exprimer les doléances du peuple bissau-guinéen
: Amilcar Cabral
pourra s'exprimer à l'ONU et ira même
jusqu'à être reçu par le pape
Paul VI au Vatican en compagnie des leaders des
autres mouvements de libération du monde
lusophone (FRELIMO du Mozambique, MPLA d'Angola).
 Voir la déclaration d'Oussouye (Casamance) du
Président de la République Sénégalaise, Léopold
Sédar Senghor durant la Guerre d'Indépendance
de Guinée-Bissau.
Voir la déclaration d'Oussouye (Casamance) du
Président de la République Sénégalaise, Léopold
Sédar Senghor durant la Guerre d'Indépendance
de Guinée-Bissau.
 Conscient
de la rapide déroute portugaise, le gouverneur,
le Général António de Spínola
(1968-73), s'essaye à une stratégie
de division entre le PAIGC et les populations
locale en arguant du fait avéré
que les cadres du PAIGC étaient pour la
plupart des métis capverdiens, Amilcar
Cabral le premier. Son programme “Por
uma Guiné Melhor” (Pour une
Guinée Meilleure) est censé offrir
plus d'équité et de justice à
ceux qui, il y a si peu de temps, faisaient partie,
pour l'administration, des "non civilisés". Conscient
de la rapide déroute portugaise, le gouverneur,
le Général António de Spínola
(1968-73), s'essaye à une stratégie
de division entre le PAIGC et les populations
locale en arguant du fait avéré
que les cadres du PAIGC étaient pour la
plupart des métis capverdiens, Amilcar
Cabral le premier. Son programme “Por
uma Guiné Melhor” (Pour une
Guinée Meilleure) est censé offrir
plus d'équité et de justice à
ceux qui, il y a si peu de temps, faisaient partie,
pour l'administration, des "non civilisés".
Ce programme "Pour
une Guinée Meilleure" reposait
sur :
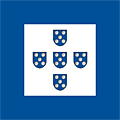 1)
le parti fasciste União Nacional (illustration
à droite : le logo du parti) 1)
le parti fasciste União Nacional (illustration
à droite : le logo du parti)
2) la petite bourgeoisie locale
indispensable pour ses compétences administratives
et ses liens avec le Portugal
3) la promotion accélérée
d'une nouvelle petite bourgeoisie composée
uniquement de "vrais fils du pays" promus
socialement dans l'administration, dans la hiérarchie
des troupes d'élite et, qui bénéficiant
d'une telle situation, sur lesquels on pourrait
un jour compter.
4) l'encouragement d'une rivalité
entre ces deux bourgeoisies, laissant aux Portugais
le soins de jouer les justes arbitres
5) le jeu de la carte ethnique
basé sur le pouvoir traditionnel valorisé
avec la création des "assemblées
du peuple" (chaque communauté ethnique
avait son assemblée) : les rivalités
entre les différentes assemblées
focalisaient les rancoeurs en faisant oublier
pour un temps que l'occupant portugais était
à la base du problème. Le recrutement
militaire permettait également la division
du pays grâce à un recrutement ethnique
attirant sur l'éthnie recrutée la
haine des ethnies maintenues en dehors de l'armée
d'occupation.
Un autre aspect important du programme
"Pour une Guinée Meilleure"
reposait sur une propagande aggressive et omniprésente
:
- implication directe des militaires, base
du véritable pouvoir colonial, dans la
propagande en vue de diminuer l'influence du PAIGC.
Pour s'attirer la sympathie du peuple, l'armée
ira jusqu'à prêter ses camions pour
le transport de matérieux de construction
des habitations dans les villages !
- augmentation du nombre d'enseignants dans le
primaire (les zones contrôlées par
le PAIGC avaient créé leur propre
système scolaire)
- amélioration du système de santé
par la construction de dispensaires
- promotion des populations locales dans le sport
et notamment dans les équipes de football
- développement et utilisation intensive
des médias : journaux télévisés,
radio, programmes culturels, temps d'antennes
en langues locales offerts aux différentes
communautés ethniques
- diffusion à grande échelle de
prospectus de propagande
- déplacement en personne du gouverneur
Spínola (qui deviendra en 1974 le président
du Portugal) arrivant du ciel en hélicoptère
pour palabrer, entouré d'enfants, avec
la population et écouter leurs doléances
(manque de riz ou d'écoles).
La carotte n'était bien
sûr qu'une partie de la politique du gouverneur.
Le bâton avait plus que jamais sa place
: ceux qui n'étaient pas "du bon côté"
étaient châtiés sans pitié
(nombreuses excécutions arbitraires).
Malgré toute cette énergie
dévouée au programme "Pour
une Guinée Meilleure", cette opération
était morte-née. L'indépendance
était inéluctable en dépit
de l'aveuglement du Portugal qui pensera règler
le problème d'une manière pour le
moins expéditive : il fera assassiné
le 20 janvier 1973, à Conakry, Amilcar
Cabral, leader du PAIGC, par petit commando
armé. Cet évènement, au lieu
de retarder la conclusion du conflit ne fit que
la précipiter. En mars de cette même
année, le premier avion de combat Fiat
G-91 est abattu par un missile sol-air Strella.
En représailles de l'assassinat d'Amilcar
Cabral, une opération militaire d'envergure
portant le nom du défunt leader est en
outre lancée dans le quart sud-ouest du
pays pour prendre la place forte de Guiledje,
entre Quebo et Cacine, précipitant la fin
de la présence portugaise en Guinée.
Le 22 mai 1973, le Sud-Ouest de la Guinée
est conquis et occupé par le PAIGC.
Quatre plus tard, le 24 septembre
1973, la première Assemblée Nationale
Populaire est convoquée pour déclarer
l'indépendance et la création de
l'état souverain de la République
de Guinée-Bissau. Ce nouvel état
est immédiatement reconnu par 63 pays de
la communauté internationale et rentre
à l'ONU. Luís Cabral, demi-frère
d'Amilcar est alors élu premier Président
de la République. C'est à 5000 kilomètres
de la Guinée-Bissau que se scellera la
dernière étape du processus menant
le pays mais aussi les autres colonies portugaises
à l'indépendance totale : le 25
avril 1974, les militaires portugais conscients
du désastre militaire et de la nécessité
de mettre fin à l'empire colonial déclenchent
la "Révolution des Oeillets"
qui met fin à 48 années de dictature.
Les forces d'occupation sont immédiatement
retirées de Guinée-Bissau.
L'indépendance
Dès l'indépendance, le nouveau
gouvernement du PAIGC connut de nombreux
problèmes. Les Portugais n'avaient en effet vu
dans la Guinée qu'un grenier à arachides et à
huile de palme. A l'inverse des colonies françaises
et anglaises, aucune véritable infrastructure
n'avait jamais été construite. Que restait-il
de ces 500 ans de colonisation ? Une brasserie
destinée à fournir la bière aux troupes portugaises,
quelques petites usines pour le décorticage du
riz et de l'arachide, 14 diplômés d'Université,
et pas un seul docteur ! Un analphabétisme touchant
95% de la population, une espérance de vie
de 35 ans et 45% des enfants morts avant l'âge
de cinq ans.
Les premières années d'indépendance
sont marquées par un gouvernement dirigé
par un "parti-état" comme dans
la plupart des nouvelles républiques communistes.
Les structures administratives restent cependant
calquées sur le modèle colonial.
Le PAIGC omniprésent dans l'appareil d'état
peut alors imposer un dirigisme sans faille et
un système autoritaire.
Le 14 novembre 1980, le Président Luís
Cabral voulant unifier le Cap Vert et la Guinée-Bissau
est renversé par un coup d'état.
Ce push, commandité par le premier ministre
en fonction Nino Vieira, brise l'unité
Guinée-Bissau/Cap Vert qui avait mené
les deux entités à l'indépendance.
Une période de purge commence alors. Dissidents
et opposants en feront les frais.
Durant des années, la Guinée-Bissau a suivi la voie africaine du Marxisme Léninisme,
c'est à dire "rien au peuple et tout au gouvernement".
Un pouvoir familial s'est instauré et le pays
s'est fermé au monde. Rares sont donc les étrangers
qui connurent la Guinée-Bissau avant le début
des années 90. Les rares entreprises étaient bien-sûr
dirigées par l'État. Les conditions économiques
étaient si mauvaises que trouver de la nourriture
était presque une activité clandestine; les ménagères
pouvaient passer quatre ou cinq heures par
jour à chercher les denrées nécessaires.
Le processus "d'ajustement structurel"
imposé par la Banque Mondiale et qui fera
le malheur de nombreux pays pauvres est introduit
en Guinée-Bissau en 1985 pour mener à
de nombreuses réformes économiques
et en particulier à la libéralisation
de ce secteur. Cette libéralisation économique
sera suivie six ans plus tard, en 1991, par la
libéralisation politique avec le fin du
PAIGC parti unique.
La fin des années 90 est
marquée par l'ouverture progressive du
pays. La situation économique n'a cependant
jamais été aussi mauvaise qu'à
cette période : toutes les infrastructures
tombent en ruine y compris à Bissau : eau
courante disponible deux heures par jour, en même
temps que l'électricité et services
publics en faillite. L'inflation permanente du
pesos bissau-guinéen rend les achats de
produits aventureux : les prix augmentent chaque
jour et la plus grosse coupure, 10.000 pesos,
ne permet rien d'acheter si bien que les billets
sont agrafés par liasses de 10...
Pour remédier à
cela, la Guinée-Bissau choisit en 1998
de passer au franc CFA, monnaie partagée
par la plupart des pays francophones d'Afrique
et qui est protégée par la Banque
de France. Cette transition monétaire sera
l'une des causes d'une période tourmentée
qui dure jusqu'à présent : lors du passage au CFA,
les Bissau-Guinéens ont été
invités à changer tous leurs pesos
contre la nouvelle monnaie. Si ce changement stoppa
l'inflation elle provoqua une brusque et importante
augmentation des prix qui priva la population
urbaine des produits alimentaires les plus nécessaires.
La colère de la population procura à
l'armée, dirigée par un héros
de la guerre d'indépendance, le général
Ansumane Mané, une raison et une occasion
de se soulever tout en ayant un grand soutien
populaire. Ecarté de l'armée par
le président Vieira quelques jours auparavant
au prétexte de soutenir la rébellion
en Casamance (Sénégal), Ansumane
Mané déclencha une insurrection
en formant une junte militaire. Vieira est renversé par la junte le 7 mai 1999.
C'est le début d'une période
instable qui dure encore en 2012 et
durant laquelle coups d'état et gouvernements
transitoires vont se succèder.
En février 2000, Kumba Ialá, leader de l’opposition, fut élu à l’issue de deux tours d'une élection présidentielle qualifiée de transparente par les observateurs. Il établit un gouvernement provisoire, mais le retour à la démocratie fut compliqué par une économie dévastée par la guerre civile et la propension de l’armée à s’immiscer dans les affaires gouvernementales.
En septembre 2003, un coup d’État mené par le Général Veríssimo Correia Seabra déposa Ialá. Reportées plusieurs fois, les élections législatives eurent finalement lieu en avril 2004. Seabra fut tué en octobre de la même année par des factions mutinées. D’après le premier ministre Carlos Gomes, les mutins étaient des soldats au service de l’ONU rentrés du Libéria et insatisfaits de n’avoir pas encore été payés. Vieira, de retour de son exil au Portugal, fut réélu président le 24 juillet 2005. Ce retour sera de courte durée puisque le 2 mars 2009, ce bon vieux Nino "Cocaïne" Vieira est enfin assassiné sans doute pour des affaires liées aux barons de la drogue colombiens qu'il protègeait au grè de ses envies. Depuis cette date du 2 mars 2009, le pays a connu 3 chefs d'états dont deux par intérim (c'est le cas ce jour 24 mars 2012) et un président élu Malam Bacai Sanha mort du SIDA à Paris le 9 janvier 2012.
 VOIR LA PAGE
SUR LA GUERRE EN GUINEE-BISSAU
VOIR LA PAGE
SUR LA GUERRE EN GUINEE-BISSAU
 VOIR LA LISTE DES CHEFS D'ETAT DE LA GUINEE-BISSAU VOIR LA LISTE DES CHEFS D'ETAT DE LA GUINEE-BISSAU
|
Bibliographie
- (en) Richard Lobban et Peter Karibe Mendy, Historical dictionary of the Republic of Guinea-Bissau, Scarecrow Press, Lanham (Md.), Londres, 1997 (3e éd.), XXIII-411 p. (ISBN 0-8108-3226-7)
- (fr) René Pélissier, Naissance de la « Guiné » : Portugais et Africains en Sénégambie, 1841-1936, Pélissier, Orgeval, 1989, 485 p. (ISBN 2-902804-08-3)
- (pt) Zamora Induta, Guiné, 24 anos de independência, 1974-1998, Hugin, Lisbonne, 2001, 196 p. (ISBN 972-794-078-1)
- (pt) Fernando Amaro Monteiro et Teresa Vázquez Rocha, A Guiné do século XVII ao século XIX : o testemunho dos manuscritos, Ed. Prefácio, Lisbonne, 2004, 287 p. (ISBN 972-8816-61-8)
- (pt) Gomes Eanes de Zurara, Crónica dos feitos de Guiné (préface, sélection et notes de Álvaro Júlio da Costa Pimpão), Livraria Clássica Editora A.M. Teixeira, Lisbonne, 1942, 85 p.
|
|
|
|
|