|

Photo ci-dessus : la pomme de cajou et sa noix, fruit
de l'anacardier est la richesse agricole nationale (Photo Christian COSTEAUX)
 L'agriculture
représente en Guinée-Bissau 62% du PNB, 82% des
emplois, et près de 100% des exportations. La
principale culture (et le principal aliment) est le
riz. Mais le climat humide permet de cultiver beaucoup
de fruits et légumes : maïs, arachide, manioc, noix
de cajou, noix palmistes, coton, mangues, oranges, papayes,
ananas, etc....La pêche est encore un potentiel mal
exploité par les artisans locaux et laissé en
concession à des pays étrangers. L'agriculture
représente en Guinée-Bissau 62% du PNB, 82% des
emplois, et près de 100% des exportations. La
principale culture (et le principal aliment) est le
riz. Mais le climat humide permet de cultiver beaucoup
de fruits et légumes : maïs, arachide, manioc, noix
de cajou, noix palmistes, coton, mangues, oranges, papayes,
ananas, etc....La pêche est encore un potentiel mal
exploité par les artisans locaux et laissé en
concession à des pays étrangers.
Dans l'ensemble, les zones rurales
sont autosuffisantes au niveau vivrier. Seules les régions
les plus orientales peuvent connaître occasionnellement
des périodes de soudure* difficiles
puisqu'elles sont situées en zone sahéliennes
et subissent parfois des hivernages peu pluvieux. Plusieurs
autres facteurs peuvent hypothèquer les chances
d'une bonne récolte : des chaleurs excessives,
une sécheresse pluri-annuelle ou des migrations
de criquets.
Mais des problèmes beaucoup plus chroniques et
dont la cause est l'homme montrent une mauvaise gestion
de l'agriculture : les brûlis à répétition
qui mettent le feu à la brousse et érodent
les sols, une déforestation inquiétante
et la surexploitation des terres rendent l'avenir du
monde paysan bien sombre.
| * soudure : en Afrique sahélienne,
on appelle "soudure" la période
entre le début de la saison des pluies (qui
coincide avec le début des travaux agricoles)
et le début des premières récoltes.
Durant ce laps de temps qui peut durer de quelques
semaines à deux ou trois mois, le monde agricole
doit vivre sur les réserves restantes de
la récolte de l'année précédente.
Lorsque les récoltes de l'année précédente
ont été mauvaises et que les récoltes
de l'année en cours tardent à venir,
un grave "déficit alimentaire"
peut advenir. |
Les terres considérées
comme arables ne couvrent que 8,31% du territoire bissau-guinéen.
Les cultures permanentes constituées principalement
de petits potagers n'occupent quant à elles pas
plus de 7% du pays (chiffres 2005, sources : FAO). Près
de 250km² de terres sont irriguées en Guinée-Bissau.
Photo à gauche :
une paysanne et sa récolte quotidienne de bananes
près de Varela
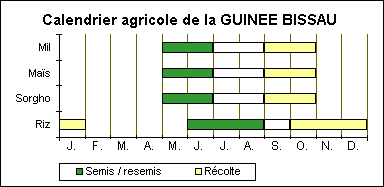
Comme en Casamance, la culture du riz
est une activité traditionnelle qui a su au fil
des siècles s'adapter au terroir. Des techniques
très avancées ont été mises
en place même si l'outil utilisé (le kadiandou)
offre hélas un rendement très moyen.
L'ensemble du littoral et les nombreux
estuaires sont occupés par la mangrove et les
rizières. Les zones rizicoles sont mises à
"dessaler" durant les premières pluies
d'hivernage grâce à des systèmes
de canaux d'évacuation et de circulation des
eaux.
Une fois que la salinité de
la terre est devenue compatible avec la culture, les
hommes partent en groupe remuer la terre et creuser
de profonds sillons avec une grosse pelle appelée
"kadiandou" chez les Floups. C'est ensuite
au tour des femmes de semer le riz dont les graines
proviennent des greniers de stockage de l'année
précédente. Une fois les premières
pousses de riz hautes d'une dizaine de centimètres,
ce seront encore les femmes qui repartiront dans les
champs pour les replanter d'une manière règulière
afin de favoriser la croissance de la céréale.
La production totale de riz montre
une tendance à la baisse ces dernières
années même si 2005 semble avoir été
une année faste. Le fort exode rural des jeunes
qui quittent les zones de culture pour émigrer
en ville ainsi que l'instabilité à la
frontière de la Casamance sont deux facteurs
notables qui peuvent expliquer cette baisse.
Production
de riz en Guinée-Bissau de 2000 à 2005
exprimée en tonnes (sources FAO)
| |
2000 |
2001
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| production de riz (en tonnes) |
106
081 |
85
056 |
87 865 |
66 424 |
89 192 |
98 340 |
|
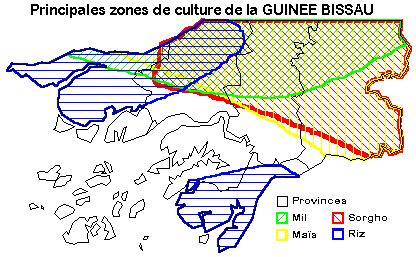
A l'inverse du riz, cultivé
dans les plaines inondées du littoral, les autres
céréales sont principalement cultivées
à l'Est du pays par les populations mandingues
et peulhs. Les zones de culture du sorgho et du maïs
se confondent alors que l'aire de production du mil
se situe au nord de la latitude de Bafatá (le
mil ne peut pousser dans des zones trop arrosées).
La mécanisation de la culture de ces céréales,
comme celle du riz, est nulle. Les paysans n'utilisent
exclusivement que des outils traditionnels de labour
et de moisson parfois aidés par un boeuf et un
cheval. Il en résulte une productivité
assez basse. La production cumulée du mil, du
maïs, du sorgho et du fonio n'atteint pas celle
du riz. L'année 2004 et plus encore l'année
2005 ont été des années exceptionnelles
au niveau de la production de ces céréales
avec de récoltes qui n'avaient plus été
atteintes depuis très longtemps. Une aubaine
pour les paysans qui en 2003 avaient connu une des pires
récoltes des cinquantes dernières années.
Le maïs quant à lui est
une production récente en Guinée-Bissau.
Il n'est resté longtemps qu'une céréale
marginale dont on ne cultivait que quelques épis
autour de la concession familiale. On en produisait
à peine 3000 tonnes avant l'Indépendance
et cette valeur n'a globalement fait qu'augmenter depuis
: d'une dizaine de tonnes en 1985, la production est
passée à une quinzaine de tonnes en 1995
et à 40 tonnes en 2005. La farine de maïs
est devenue une composante indispensable de la gastronomie
bissau-guinéenne. En outre, les épis frais
grillés le long des routes ont offert une activité
supplémentaire aux femmes commerçantes.
A l'inverse, le fonio, céréale
traditionnelle de cette partie de l'Afrique, est peu
à peu abandonné. On en cultivait plus
de 10.000 tonnes par an avant l'Indépendance.
En 1985, à peine 5000 tonnes et en 1995 seules
2500 tonnes de fonio sortaient de terre. Avec une production
de 698 tonnes en 2003 et 2295 tonnes en 2005, on peut
voir dans le fonio une culture devenue marginale. Ceci
s'explique avant tout par l'extrême difficulté
du traitement de cette céréale. En effet,
pour être débarassé de son enveloppe,
le grain de fonio (de très petite taille) doit
être pilé durant des heures (activité
essentiellement féminine). Ce travail très
éprouvant a consacré l'extinction du fonio
dans l'alimentation au profit de céréales
plus pratique.
Le mil et le sorgho, céréales
assez similaires, voient leur production évoluer
assez peu excepté durant les années exceptionnelles
quand de bonnes pluies viennent la doper ou une sécheresse
dramatique la réduire. La Guinée-Bissau,
grâce aux aides extérieures ou aux cotisations
villageoises s'équipe de plus en plus de moulins
à mil. C'est sans doute ce qui contribue à
sauver ces céréales à la différence
du fonio qui doit toujours être traité
au mortier. Le mil et le sorgho sont au niveau national
moins consommés que le riz mais la proportion
de leur consommation à l'Est, dans leurs zones
de culture, est beaucoup plus grande.
NB : la Guinée-Bissau
doit importer chaque année une moyenne de 75.000
tonnes de céréales pour satisfaire ses
besoins alimentaires (soit près d'un tiers de
sa consommation).
Production
de céréales (hors riz) en Guinée-Bissau
de 2000 à 2005 exprimée en tonnes (sources
FAO)
| Production (en tonnes) |
2000 |
2001
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Fonio |
3 938 |
2 851 |
1 520 |
698 |
1 836 |
2 295 |
| Mil |
21 096 |
28 604 |
24 243 |
22 669 |
31 473 |
47 209 |
| Sorgho |
21 096 |
15 082 |
14 703 |
10 025 |
15 506 |
23 359 |
| Maïs |
25 673 |
28 088 |
22 113 |
20 639 |
31 868 |
39 835 |
|
La production de fruits est doublement
importante : elle permet de diversifier toute l'année
l'alimentation des Bissau-Guinéens grâce
à une large variété d'arbres fruitiers.
Elle est également la principale source d'exportation
et de devises étrangères grâce à
la noix de cajou.
 La
noix de cajou est la richesse nationale. La Guinée-Bissau
occupe le 6ème rang mondial de ses producteurs.
C'est l'Inde, principal producteur, qui pour pouvoir
contrôler à sa guise les cours de la précieuse
noix achète la quasi-intégralité
de la production nationale. C'est sur l'anacardier que
pousse la pomme de cajou (rouge ou jaune) à l'extérieur
de laquelle se forme la noix. La pomme se consomme comme
tel quel. Elle est très juteuse et très
sucrée bien que sa chair n'ait pas une consistance
très agréable. Elle sert surtout à
fabriquer l'alcool
national : le caju qui promet des nuits d'ivresse
toute l'année dans tout le pays ! La saison de
récolte des noix met le pays en effervescence.
Tous les camions sont réquisitionnés pour
transporter les dizaines de milliers de tonnes de noix
vers Bissau où elles sont embarquées sur
des bateaux à destination de l'Inde. Les balances
du port de Pidjiguiti pèsent chaque véhicule
et c'est l'état, qui négocie lui-même
le prix avec l'importateur, qui paiera la production
aux paysans. Seule une infime partie des noix seront
consommées sur place. La
noix de cajou est la richesse nationale. La Guinée-Bissau
occupe le 6ème rang mondial de ses producteurs.
C'est l'Inde, principal producteur, qui pour pouvoir
contrôler à sa guise les cours de la précieuse
noix achète la quasi-intégralité
de la production nationale. C'est sur l'anacardier que
pousse la pomme de cajou (rouge ou jaune) à l'extérieur
de laquelle se forme la noix. La pomme se consomme comme
tel quel. Elle est très juteuse et très
sucrée bien que sa chair n'ait pas une consistance
très agréable. Elle sert surtout à
fabriquer l'alcool
national : le caju qui promet des nuits d'ivresse
toute l'année dans tout le pays ! La saison de
récolte des noix met le pays en effervescence.
Tous les camions sont réquisitionnés pour
transporter les dizaines de milliers de tonnes de noix
vers Bissau où elles sont embarquées sur
des bateaux à destination de l'Inde. Les balances
du port de Pidjiguiti pèsent chaque véhicule
et c'est l'état, qui négocie lui-même
le prix avec l'importateur, qui paiera la production
aux paysans. Seule une infime partie des noix seront
consommées sur place.
Photo à droite
: Séchage des noix de cajou pour la consommation
locale
 Un
site dédié à la noix de cajou de Guinée-Bissau
Un
site dédié à la noix de cajou de Guinée-Bissau
Production
de noix de palmier à huile en Guinée-Bissau
de 2000 à 2005 exprimée en tonnes (sources
FAO)
| Production (en tonnes) |
2000 |
2001
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Noix de palmier à huile |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Production
de noix de cajou (anacarde) en Guinée-Bissau
de 2000 à 2005 exprimée en tonnes (sources
FAO)
| Production (en tonnes) |
2000 |
2001
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Anacardes |
72
725 |
85
000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|
 L'huile
de palme est également une source de devise intéressante.
Elle est principalement consommée sur place comme
accompagnement lipidique de la plupart des plats. Au
Sénégal, c'est une huile de luxe. C'est
donc tout naturellement vers ce pays que la Guinée-Bissau
exporte son surplus. Cette huile rouge assez épaisse
est traitée par l'écrasement, le filtrage
et le raffinage des noix palmistes. Si la cueillette
est une activité masculine, le reste du traitement
est effectué par les femmes qui sont ensuite
chargées de négocier au mieux la vente
de la précieuse huile (un litre se vend au détail
à Dakar à plus de 1500CFA). L'huile
de palme est également une source de devise intéressante.
Elle est principalement consommée sur place comme
accompagnement lipidique de la plupart des plats. Au
Sénégal, c'est une huile de luxe. C'est
donc tout naturellement vers ce pays que la Guinée-Bissau
exporte son surplus. Cette huile rouge assez épaisse
est traitée par l'écrasement, le filtrage
et le raffinage des noix palmistes. Si la cueillette
est une activité masculine, le reste du traitement
est effectué par les femmes qui sont ensuite
chargées de négocier au mieux la vente
de la précieuse huile (un litre se vend au détail
à Dakar à plus de 1500CFA).
En plus des très lucratives productions de noix
de cajou et de noix palmistes, la Guinée-Bissau
produit chaque année plus de 18.000 tonnes de
fruits tropicaux. Les manguiers sont omniprésents
dans tout pays. Chaque famille en a au moins un dans
sa concession. C'est aussi le cas des papayers et des
bananiers. Quelques bananeraies d'importance à
travers le pays ont une production industrielle. La
banane plantain, les "oranges" (une espèce
de pamplemousse local) et une foule de fruits sauvages
sont également récoltés dans les
différentes régions bissau-guinéennes.
Photo à gauche : alignement de manguiers
à Quinhamel (photo Christian COSTEAUX)
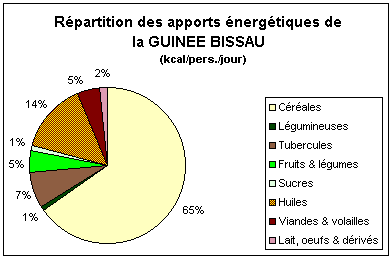
65% des apports énégertiques de l'alimentation
des Bissau-Guinéens proviennent des céréales.
D'autres cultures vivrières
ou de rente offres des revenus aux agriculteurs :
Les tubercules ont le vent en poupe : manioc, ignames,
patates douces, etc... ont un succès grandissant
chez les consommateurs et donc chez les paysans. Outre
le fait qu'il ne s'agit pas de cultures saisonnières,
elles ont un rendement calorie/m² très intéressant.
L'arachide est également cultivée dans
le Nord du pays mais dans une quantité trop faible
pour être exportée (20.000 tonnes en 2005).
Elle est destinée à être broyée
pour faire de la pâte d'arachide utilisée
comme sauce riche ou tout simplement à être
grillée sous forme de "cacahuètes".
Le coton, dépourvu de tout système de
commercialisation officiel est lui aussi utilisé
artisanalement pour une petite production familiale
de tissu fait main et d'huile de graine de coton.
Production
d'arachide, de coton et de tubercules en Guinée-Bissau
de 2000 à 2005 exprimée en tonnes (sources
FAO)
| Production (en tonnes) |
2000 |
2001
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Tubercules (manioc, igname, etc...) |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
| Arachide |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
| Coton |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|
 L'élevage
est quant à lui très peu développé.
Si les Peulhs, et plus généralement les
populations musulmanes, possèdent quelques beaux
troupeaux de moutons, la plupart des animaux appartiennent
aux familles qui n'en élèvent rarement
plus d'une dizaine. La plus grande densité d'animaux
d'élevage se trouve donc à l'Est, sur
le terroir peulh. Les porcs, particulièrement
adaptés au climat du pays et résistants
aux maladies sont eux très appréciés
dans Bissau et sa périphérie. Quelques
poulets et boeufs de race N'dama (petits et trappus)
offrent en outre de quoi célébrer les
fêtes traditionnelles et étapes de la vie
des Bissau-Guinéens. L'élevage
est quant à lui très peu développé.
Si les Peulhs, et plus généralement les
populations musulmanes, possèdent quelques beaux
troupeaux de moutons, la plupart des animaux appartiennent
aux familles qui n'en élèvent rarement
plus d'une dizaine. La plus grande densité d'animaux
d'élevage se trouve donc à l'Est, sur
le terroir peulh. Les porcs, particulièrement
adaptés au climat du pays et résistants
aux maladies sont eux très appréciés
dans Bissau et sa périphérie. Quelques
poulets et boeufs de race N'dama (petits et trappus)
offrent en outre de quoi célébrer les
fêtes traditionnelles et étapes de la vie
des Bissau-Guinéens.
Photo à droite
: un porc dans le quartier de Bandim à
Bissau
Production de porcs
en Guinée-Bissau de 2000 à 2005 exprimée
en nombre de têtes (sources FAO)
| Production (en milliers de têtes) |
2000 |
2001
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| Poulets |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
1 500 |
1 550 |
1 600 |
| Boeufs |
512 |
515 |
515 |
520 |
520 |
530 |
| Moutons + chèvres |
605 |
610 |
610 |
620 |
620 |
635 |
| Porcs |
345 |
350 |
350 |
360 |
360 |
370 |
|
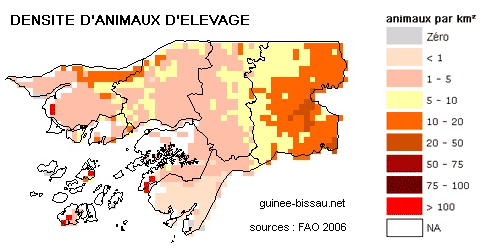 Dans
la plupart des communautés du pays, la possession
d'un boeuf, ou de plusieurs, est un signe de réussite
et de richesse. Tuer un bovin demeure encore souvent
un évènement festif réalisé
à l'occasion d'un décès, d'un mariage,
d'une initiation, etc... Dans
la plupart des communautés du pays, la possession
d'un boeuf, ou de plusieurs, est un signe de réussite
et de richesse. Tuer un bovin demeure encore souvent
un évènement festif réalisé
à l'occasion d'un décès, d'un mariage,
d'une initiation, etc...
L'élevage de poulets est assez
nouveau car jusqu'à présent toutes les
familles en possédaient quelques-uns dans la
cour sans que leur nombre excède une petite dizaine.
Comme dans la plupart des pays d'Afrique,
le poulet est petit à petit devenu un aliment
de consommation courante. Sa facilité d'élevage,
de transport et de vaccination (comprimés) au
sein d'une population de plus en plus urbaine a consacré
son succès. Depuis 15 ans, le nombre de poulets
d'élevage ne cesse d'augmenter en Guinée-Bissau.

Quelques photos d'un projet italien de développement
agricole 
 Cartes
agricoles de la Guinée-Bissau sur le site de
la FAO 
|